
Salarié ou chef d’entreprise, le point mort est à définir, comprendre et à connaître. Si je vous parlais, avant-hier, de trésorerie, le concept de point mort y est indirectement lié. Par abus de langage, on l’appelle aussi « seuil de rentabilité ». La rentabilité étant en finance utilisée pour parler de rentabilité économique ou de rentabilité des capitaux propres, afin de mesurer l’enrichissement des actionnaires par rapport aux profits générés par l’outil économique de l’entreprise.
On parle de point mort quand l’entreprise ne réalise ni bénéfice, ni perte. Le point mort, c’est le chiffre d’affaires pour lequel l’entreprise ne dégage aucun résultat. Cet indicateur est utilisé pour mesurer le risque d’exploitation. Vous avez suffisamment de bon sens pour comprendre que si les achats sont supérieurs aux revenus, alors il y a une perte. C’est un déficit comptable, qui se traduira, tôt ou tard, par un solde de trésorerie qui correspond à un débours de cash. Et si chaque année une entreprise perd de l’argent plutôt que d’en gagner, nous avons vu ensemble ce mardi que la banque peut décider d’arrêter de vous prêter de l’argent ! Mauvaise exploitation, pas d’argent, c’est la faillite.
Allons rendre visite à Paul qui fabrique des pots de sauces tomates dans son atelier Cortenais. Il a vendu l’année dernière 100 000 pots à 5€. Il a donc réalisé 500 000 € de chiffre d’affaires. Chaque fois que Paul fabrique un pot, le coût de matière première et de fournitures est de 2€ par pot. L’entreprise a payé pour 350 000 € de charges fixes dans l’année. Les charges fixes sont, par convention, des frais qui ne varient au prorata des quantités vendues (salaires, loyers, assurances…). Un coût fixe évolue quand la structure de la société s’accroît, ou décroit : Baisse drastique de la fabrication, ou au contraire, nouveaux investissements et nouveaux collaborateurs.
Quel est donc le résultat que la société ? Et bien, si l’entreprise a fabriqué 100 000 pots et qu’ils ont coûté 2€, cela fait une charge de 200 000€. Si l’on ajoute cela aux charges fixes, le coût total est de 550 000 €. Et là, c’est le drame ! Paul a réalisé 500 000 € de chiffre d’affaires, qui se transformeront en encaissement, et 550 000 € d’achat, qui se transformeront en débours de trésorerie ! La société est en perte comptable de 50 000 €, et comme tôt ou tard les ventes seront encaissées et les charges payées, cela se traduira par un solde négatif du même montant.
Quel est donc le niveau de chiffre d’affaires, ou le nombre de pots de sauce tomate, que Paul doit fabriquer et vendre pour couvrir les 50 000 € de déficit ? Comme tout débutant de 1ère année qui découvre la finance et qui répond précipitamment, vous pourriez être tenté de dire que si le pot se vend 5€, puisqu’il manque 50 000 €, alors il faut vendre 10 000 pots de plus ! Et bien non, c’est une erreur de raisonnement.
Pourquoi ?
D’abord parce que vos 10 000 pots supplémentaires ne sont pas gratuits, ils vont couter 2€ chacun à leur tour. Ensuite, il se peut que la réalisation des pots supplémentaires nécessite un coût fixe supplémentaire, avec l’embauche d’un nouveau salarié par exemple, ce qui aurait pour effet de ne pas résorber le déficit. Dans ce raisonnement, nous aurions donc 110 000 pots, à 5 € de prix de vente, pour un chiffre d’affaires de 550 000 €. Les pots couteraient 2€ chacun, soit 220 000 €. Si les coûts fixes n’évoluent pas, alors le résultat est de 550 000 – 200 000 – 350 000 = -20 000 €. 10 000 pots supplémentaires n’est pas la bonne réponse.
La technique de calcul du point mort, dans cet exemple volontairement simpliste, peut se faire au doigt mouillé. Dans la pratique, il nécessite de séparer les charges dites « variables », c’est-à-dire les charges qui sont obligatoirement nécessaires pour pouvoir vendre : si je vends un pot de sauce tomate, j’ai dû le fabriquer, et j’ai dû acheter un pot et des tomates (un pot de sauce tomate sans pot, c’est assez improbable !).
Si je ne vends rien, hormis mon stock, inutile de fabriquer. La distinction entre les coûts variables et les coûts fixes vous permet de déterminer une marge sur les coûts variables. Elle est la différence entre votre chiffre d’affaires et vos charges variables. Dans notre exemple, 550 000 – 220 000 = 330 000 € de marge sur coût variable, soit, 60% du chiffre d’affaires (330 000 / 550 000). Le calcul du point mort nécessite de prendre en compte les deux paramètres connus, à savoir le taux de marge et le montant des coûts fixes : 350 000 / 60% = 583 334 € de chiffre d’affaires, soit 116 667 pots à vendre.
Arrêtez-vous ici quelques instants, refaites le calcul initial, et vous verrez, avec ce nombre de pot, l’entreprise ne dégage ni bénéfice, ni perte. C’est votre point mort.
Pourquoi l’utilise-t-on ? D’abord, vous veillez à maîtriser le risque d’exploitation. Plus vous êtes proche du point mort, plus, il faut bien l’avouer, ça craint ! Votre entreprise peine à dégager des bénéfices conséquents et cela peut menacer la profitabilité de la société, faire baisser le rendement attendu par les actionnaires et générer une baisse de la trésorerie. Plus vous êtes proche du point mort, moins vous rassurer les prêteurs. Ensuite, c’est un outil de management : Quoi de mieux que de challenger vos équipes en étant transparent. Pour que l’entreprise puisse survivre sur le long terme, se situer en dessous de son point mort sur quelques années peut conduire à sa disparition. Utilisez la notion de point mort comme levier managérial, comme cap de survie pour toute entreprise.
Attention également à ne pas vous laisser avoir par un éventuel astigmatisme, qui est monnaie courante en finance. Le point mort peut vous balader et il faut rester attentif sur trois points :
Premier point, plus l’entreprise est proche de son point mort, plus l’évolution de son résultat de l’année 1 à 2 est exagérément supérieure à l’évolution du chiffre d’affaires sur la même période. Si une entreprise réalise une croissance de 5% de son chiffre d’affaires, et que dans le même temps, vous observez une croissance de 35% du résultat net, inquiétez-vous ! Ce n’est pas que la société affiche de superbe performance commerciale, c’est que la société est très proche de son point mort, et est encore dans une zone de danger.
Second point, plus l’entreprise a de coûts fixes, plus l’évolution du résultat est sensible au niveau d’activité. Donc si vous croisez une société qui a un résultat qui progresse avec des variations vertigineuses, observez de plus près le poids de ses charges.
Enfin, raisonnez en mode gestion : Un coût fixe, sur le long terme, ne reste pas fixe : On embauche, on licencie, on investit ou on réduit ses coûts productifs. L’entreprise améliore ses performances également en optimisant les coûts. Lorsque vous faites une analyse, soyez donc très vigilant à l’ensemble de ses aspects et raisonnez sur plusieurs années.
Mais et Paul dans tout ça ? Et bien, il a écouté nos conseils. Il a même réussi à augmenter sa production et à réduire ses coûts fixes. Souhaitons-lui beaucoup de succès dans son entreprise grandissante, qui parait-il, va bientôt embaucher.
On ne saurait trop lui conseiller de faire attention à l’impact financier de ces embauches sur son point mort !
On parle de point mort quand l’entreprise ne réalise ni bénéfice, ni perte. Le point mort, c’est le chiffre d’affaires pour lequel l’entreprise ne dégage aucun résultat. Cet indicateur est utilisé pour mesurer le risque d’exploitation. Vous avez suffisamment de bon sens pour comprendre que si les achats sont supérieurs aux revenus, alors il y a une perte. C’est un déficit comptable, qui se traduira, tôt ou tard, par un solde de trésorerie qui correspond à un débours de cash. Et si chaque année une entreprise perd de l’argent plutôt que d’en gagner, nous avons vu ensemble ce mardi que la banque peut décider d’arrêter de vous prêter de l’argent ! Mauvaise exploitation, pas d’argent, c’est la faillite.
Allons rendre visite à Paul qui fabrique des pots de sauces tomates dans son atelier Cortenais. Il a vendu l’année dernière 100 000 pots à 5€. Il a donc réalisé 500 000 € de chiffre d’affaires. Chaque fois que Paul fabrique un pot, le coût de matière première et de fournitures est de 2€ par pot. L’entreprise a payé pour 350 000 € de charges fixes dans l’année. Les charges fixes sont, par convention, des frais qui ne varient au prorata des quantités vendues (salaires, loyers, assurances…). Un coût fixe évolue quand la structure de la société s’accroît, ou décroit : Baisse drastique de la fabrication, ou au contraire, nouveaux investissements et nouveaux collaborateurs.
Quel est donc le résultat que la société ? Et bien, si l’entreprise a fabriqué 100 000 pots et qu’ils ont coûté 2€, cela fait une charge de 200 000€. Si l’on ajoute cela aux charges fixes, le coût total est de 550 000 €. Et là, c’est le drame ! Paul a réalisé 500 000 € de chiffre d’affaires, qui se transformeront en encaissement, et 550 000 € d’achat, qui se transformeront en débours de trésorerie ! La société est en perte comptable de 50 000 €, et comme tôt ou tard les ventes seront encaissées et les charges payées, cela se traduira par un solde négatif du même montant.
Quel est donc le niveau de chiffre d’affaires, ou le nombre de pots de sauce tomate, que Paul doit fabriquer et vendre pour couvrir les 50 000 € de déficit ? Comme tout débutant de 1ère année qui découvre la finance et qui répond précipitamment, vous pourriez être tenté de dire que si le pot se vend 5€, puisqu’il manque 50 000 €, alors il faut vendre 10 000 pots de plus ! Et bien non, c’est une erreur de raisonnement.
Pourquoi ?
D’abord parce que vos 10 000 pots supplémentaires ne sont pas gratuits, ils vont couter 2€ chacun à leur tour. Ensuite, il se peut que la réalisation des pots supplémentaires nécessite un coût fixe supplémentaire, avec l’embauche d’un nouveau salarié par exemple, ce qui aurait pour effet de ne pas résorber le déficit. Dans ce raisonnement, nous aurions donc 110 000 pots, à 5 € de prix de vente, pour un chiffre d’affaires de 550 000 €. Les pots couteraient 2€ chacun, soit 220 000 €. Si les coûts fixes n’évoluent pas, alors le résultat est de 550 000 – 200 000 – 350 000 = -20 000 €. 10 000 pots supplémentaires n’est pas la bonne réponse.
La technique de calcul du point mort, dans cet exemple volontairement simpliste, peut se faire au doigt mouillé. Dans la pratique, il nécessite de séparer les charges dites « variables », c’est-à-dire les charges qui sont obligatoirement nécessaires pour pouvoir vendre : si je vends un pot de sauce tomate, j’ai dû le fabriquer, et j’ai dû acheter un pot et des tomates (un pot de sauce tomate sans pot, c’est assez improbable !).
Si je ne vends rien, hormis mon stock, inutile de fabriquer. La distinction entre les coûts variables et les coûts fixes vous permet de déterminer une marge sur les coûts variables. Elle est la différence entre votre chiffre d’affaires et vos charges variables. Dans notre exemple, 550 000 – 220 000 = 330 000 € de marge sur coût variable, soit, 60% du chiffre d’affaires (330 000 / 550 000). Le calcul du point mort nécessite de prendre en compte les deux paramètres connus, à savoir le taux de marge et le montant des coûts fixes : 350 000 / 60% = 583 334 € de chiffre d’affaires, soit 116 667 pots à vendre.
Arrêtez-vous ici quelques instants, refaites le calcul initial, et vous verrez, avec ce nombre de pot, l’entreprise ne dégage ni bénéfice, ni perte. C’est votre point mort.
Pourquoi l’utilise-t-on ? D’abord, vous veillez à maîtriser le risque d’exploitation. Plus vous êtes proche du point mort, plus, il faut bien l’avouer, ça craint ! Votre entreprise peine à dégager des bénéfices conséquents et cela peut menacer la profitabilité de la société, faire baisser le rendement attendu par les actionnaires et générer une baisse de la trésorerie. Plus vous êtes proche du point mort, moins vous rassurer les prêteurs. Ensuite, c’est un outil de management : Quoi de mieux que de challenger vos équipes en étant transparent. Pour que l’entreprise puisse survivre sur le long terme, se situer en dessous de son point mort sur quelques années peut conduire à sa disparition. Utilisez la notion de point mort comme levier managérial, comme cap de survie pour toute entreprise.
Attention également à ne pas vous laisser avoir par un éventuel astigmatisme, qui est monnaie courante en finance. Le point mort peut vous balader et il faut rester attentif sur trois points :
Premier point, plus l’entreprise est proche de son point mort, plus l’évolution de son résultat de l’année 1 à 2 est exagérément supérieure à l’évolution du chiffre d’affaires sur la même période. Si une entreprise réalise une croissance de 5% de son chiffre d’affaires, et que dans le même temps, vous observez une croissance de 35% du résultat net, inquiétez-vous ! Ce n’est pas que la société affiche de superbe performance commerciale, c’est que la société est très proche de son point mort, et est encore dans une zone de danger.
Second point, plus l’entreprise a de coûts fixes, plus l’évolution du résultat est sensible au niveau d’activité. Donc si vous croisez une société qui a un résultat qui progresse avec des variations vertigineuses, observez de plus près le poids de ses charges.
Enfin, raisonnez en mode gestion : Un coût fixe, sur le long terme, ne reste pas fixe : On embauche, on licencie, on investit ou on réduit ses coûts productifs. L’entreprise améliore ses performances également en optimisant les coûts. Lorsque vous faites une analyse, soyez donc très vigilant à l’ensemble de ses aspects et raisonnez sur plusieurs années.
Mais et Paul dans tout ça ? Et bien, il a écouté nos conseils. Il a même réussi à augmenter sa production et à réduire ses coûts fixes. Souhaitons-lui beaucoup de succès dans son entreprise grandissante, qui parait-il, va bientôt embaucher.
On ne saurait trop lui conseiller de faire attention à l’impact financier de ces embauches sur son point mort !



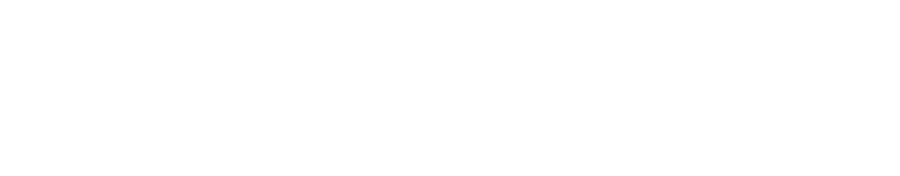








 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Version imprimable
Version imprimable





