Cette Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de tous les déportés, sans distinction, et rend hommage à leur sacrifice. Elle a pour vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur, les leçons qui s'en dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Cette journée se déroule chaque année depuis 1954, le dernier dimanche d’avril.
Sur la place Saint Nicolas, devant le monument aux morts, l’hommage a été rythmé par la lecture (enregistrée) d’un extrait de l’autobiographie de Simone Veil, « Une vie », par un élève de terminale du lycée du Fango (voir ci-dessous*), suivi du message des associations de déportés (voir ci-dessous**) lue par une jeune lycéenne en mission d’intérêt général à l’Office des Anciens Combattants.
Après les traditionnels dépôts de gerbe une minute de silence a été observée avant que ne retentisse la Marseillaise.
*Le témoignage de Simone Veil sur la déportation, extrait de son autobiographie , Une vie, publiée en 2007 aux Editions Stock. (Extrait du chapitre « la nasse », pp. 50-51.Les extraits choisis proviennent de la version publiée dans la version Livre de Poche en 2009).
«Le 13 avril, nous avons été embarquées à 5 heures du matin pour une nouvelle étape dans cette descente aux enfers qui semblait sans fin. Des autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny, où l’on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux formant un convoi aussitôt parti vers l’est. Comme il ne faisait ni trop froid ni trop chaud, le cauchemar n’a pas tourné au drame, et dans le wagon où nous nous trouvions toutes les trois, personne n’est mort au cours du voyage. Nous étions cependant effroyablement serrés, une soixantaine d’hommes, de femmes, d’enfants, de personnes âgées, mais pas de malades. Tout le monde se poussait pour gagner un peu de place. Il fallait se relayer pour s’asseoir ou s’allonger un peu. Il n’y avait pas de soldats au-dessus des wagons. La surveillance du convoi était seulement assurée par des SS dans chaque gare où il s’arrêtait. Ils longeaient alors les wagons pour prévenir que, si quelqu’un tentait de s’évader, tous les occupants du wagon seraient fusillés. Notre soumission donne la mesure de notre ignorance. Si nous avions pu imaginer ce qui nous attendait, nous aurions supplié les jeunes de prendre tous les risques pour sauter du train. Tout était préférable à ce que nous allions subir.
Le voyage a duré deux jours et demi ; du 13 avril à l’aube au 15 au soir à Auschwitz-Birkenau. C’est une des dates que je n’oublierai jamais, avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France, le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78651 sur la peau de mon bras gauche. A tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j’ai vécu ».
**Message rédigé conjointement par La Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP), La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) et les Associations de mémoire des camps nazis et L’Union Nationale des Associations de Déportés Internés de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR)
« 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s’effacer.
Ce que furent les camps d’extermination et de concentration nazis et l’horreur vécue par les millions d’êtres humains qui en furent victimes, n’est pas une simple page documentaire de l’histoire du XXe siècle. L’humanité y a été atteinte dans ce qu’elle a de plus sacré.
Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leurs vies jugées « dignes ou indignes d’être vécues » sur décision d’un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l’a portée à son paroxysme dans l’univers concentrationnaire.
Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d’extermination ou dans des camps de mort lente, par un système qui niait leur appartenance à l’espèce humaine et s’employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité.
Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l’esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre.
Il nous faut aujourd’hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l’humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur.
De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l’humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques.
Face à ces périls, l’espoir réside dans l’engagement de tous et en particulier des jeunes générations, à l’exemple des déportés, au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité.
À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd’hui un hommage solennel, et nous saluons respectueusement leur mémoire ».
Sur la place Saint Nicolas, devant le monument aux morts, l’hommage a été rythmé par la lecture (enregistrée) d’un extrait de l’autobiographie de Simone Veil, « Une vie », par un élève de terminale du lycée du Fango (voir ci-dessous*), suivi du message des associations de déportés (voir ci-dessous**) lue par une jeune lycéenne en mission d’intérêt général à l’Office des Anciens Combattants.
Après les traditionnels dépôts de gerbe une minute de silence a été observée avant que ne retentisse la Marseillaise.
*Le témoignage de Simone Veil sur la déportation, extrait de son autobiographie , Une vie, publiée en 2007 aux Editions Stock. (Extrait du chapitre « la nasse », pp. 50-51.Les extraits choisis proviennent de la version publiée dans la version Livre de Poche en 2009).
«Le 13 avril, nous avons été embarquées à 5 heures du matin pour une nouvelle étape dans cette descente aux enfers qui semblait sans fin. Des autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny, où l’on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux formant un convoi aussitôt parti vers l’est. Comme il ne faisait ni trop froid ni trop chaud, le cauchemar n’a pas tourné au drame, et dans le wagon où nous nous trouvions toutes les trois, personne n’est mort au cours du voyage. Nous étions cependant effroyablement serrés, une soixantaine d’hommes, de femmes, d’enfants, de personnes âgées, mais pas de malades. Tout le monde se poussait pour gagner un peu de place. Il fallait se relayer pour s’asseoir ou s’allonger un peu. Il n’y avait pas de soldats au-dessus des wagons. La surveillance du convoi était seulement assurée par des SS dans chaque gare où il s’arrêtait. Ils longeaient alors les wagons pour prévenir que, si quelqu’un tentait de s’évader, tous les occupants du wagon seraient fusillés. Notre soumission donne la mesure de notre ignorance. Si nous avions pu imaginer ce qui nous attendait, nous aurions supplié les jeunes de prendre tous les risques pour sauter du train. Tout était préférable à ce que nous allions subir.
Le voyage a duré deux jours et demi ; du 13 avril à l’aube au 15 au soir à Auschwitz-Birkenau. C’est une des dates que je n’oublierai jamais, avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France, le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78651 sur la peau de mon bras gauche. A tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j’ai vécu ».
**Message rédigé conjointement par La Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP), La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) et les Associations de mémoire des camps nazis et L’Union Nationale des Associations de Déportés Internés de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR)
« 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s’effacer.
Ce que furent les camps d’extermination et de concentration nazis et l’horreur vécue par les millions d’êtres humains qui en furent victimes, n’est pas une simple page documentaire de l’histoire du XXe siècle. L’humanité y a été atteinte dans ce qu’elle a de plus sacré.
Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leurs vies jugées « dignes ou indignes d’être vécues » sur décision d’un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l’a portée à son paroxysme dans l’univers concentrationnaire.
Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d’extermination ou dans des camps de mort lente, par un système qui niait leur appartenance à l’espèce humaine et s’employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité.
Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l’esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre.
Il nous faut aujourd’hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l’humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur.
De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l’humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques.
Face à ces périls, l’espoir réside dans l’engagement de tous et en particulier des jeunes générations, à l’exemple des déportés, au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité.
À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd’hui un hommage solennel, et nous saluons respectueusement leur mémoire ».



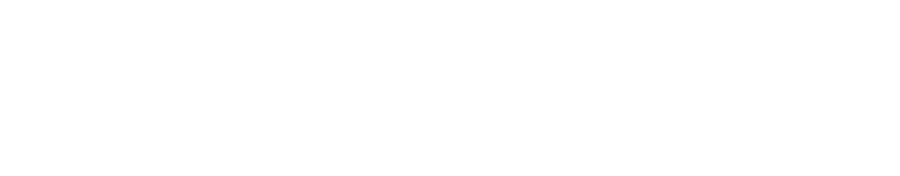



















 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Version imprimable
Version imprimable






