Malgré le reflux de l’inflation, plusieurs économistes évoquent un "coup de froid" sur la consommation des Français. Comment expliquer ce paradoxe entre une inflation en baisse et une consommation qui ne repart pas ?
Cette situation paradoxale s'explique par plusieurs facteurs. L'effet cumulé de l'inflation des dernières années a significativement érodé le pouvoir d'achat des ménages, même si le rythme de hausse des prix ralentit. Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt, malgré des baisses récentes, continue de peser sur le budget des Français, en particulier ceux ayant des crédits à taux variable ou souhaitant emprunter.
Concernant les prix, ils restent élevés en valeur absolue : le ralentissement de l'inflation signifie simplement qu'ils augmentent moins vite, pas qu'ils baissent. Par ailleurs, l’incertitude économique pousse les ménages à privilégier l'épargne de précaution plutôt que la consommation. On sait que le Français est plutôt frileux en période d’austérité, ce qui le conduit à éviter les risques d’investissement. Enfin, les incertitudes budgétaires et le chaos politique des derniers mois ont gelé de nombreux projets de consommation.
Est-ce un phénomène que l’on observe également en Corse ? Voit-on des différences notables par rapport au continent ?
La région connaît une inflation structurellement plus élevée qu'en France continentale, notamment en raison des coûts de transport et de l'insularité. En moyenne, les prix à la consommation y sont entre 4 et 6 % plus élevés selon les périodes.
Cependant, l'économie corse dépend fortement du tourisme : 31 % du PIB régional provient directement de ce secteur, et bien plus de la moitié si l’on prend en compte les dépendances intersectorielles. Cela complique l’analyse de la consommation, car celle-ci fluctue fortement en fonction des saisons. La baisse de consommation des résidents permanents peut ainsi être partiellement masquée par l’activité touristique.
Par ailleurs, avec des revenus moyens plus faibles qu’en métropole, l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Corses est potentiellement plus marqué. On retrouve évidemment les mêmes raisons que sur le continent, mais avec les spécificités insulaires en plus.
L’inflation a marqué les deux dernières années, notamment sur les produits alimentaires et l’énergie. Où en est-on aujourd’hui ? Peut-on parler d’un retour à la normale ou d’une simple accalmie ?
Selon l’INSEE, l’inflation annuelle s’est établie à +4,9 % en 2023, contre 5,2 % en 2022. On est encore loin des 1,6 % de 2021 et de l’objectif de la Banque centrale européenne de la ramener à 2 %. L’alimentaire et l’énergie – ce dernier ayant un impact direct sur le premier – ont été les deux principaux moteurs de l’inflation.
Une accalmie semble se dessiner, notamment avec l’annonce de la baisse des taux directeurs, mais il est encore trop tôt pour parler d’un retour à la normale.
L’Insee indique que le pouvoir d’achat des Français a augmenté de 0,7 % au troisième trimestre 2024. Comment cette hausse se traduit-elle concrètement dans le quotidien des ménages ?
Cette hausse du pouvoir d’achat résulte d’un ensemble de facteurs : une baisse de l’impôt sur le revenu des ménages, une stabilité de l’emploi salarié, une légère hausse des prestations sociales et des prix qui sont restés stables sur le trimestre.
Mais plus que le gain réel, c’est la stabilisation – peut-être temporaire – de la situation qui apporte une forme d’accalmie.
En Corse, le pouvoir d’achat évolue-t-il dans les mêmes proportions que sur le continent ? Quels sont les freins ou spécificités locales qui peuvent jouer ?
Malheureusement non. Une analyse spécifique du territoire met forcément en lumière des disparités par rapport à la moyenne nationale.
D’abord, 45 % des salariés corses ont un salaire annuel inférieur à 16 000 €, ce qui constitue un frein à la consommation. Par ailleurs, la proportion de retraités aux revenus plus faibles que la moyenne nationale est en hausse.
On observe aussi un recul de l’emploi dans des secteurs importants comme le BTP, l’hébergement et la restauration. La faible diversification de l’économie limite les opportunités salariales. Les prix à la consommation, plus élevés qu’en métropole, sont aggravés par les coûts de transport et la dépendance aux importations. Enfin, le prix du logement, particulièrement élevé, grève une grande part du budget des ménages.
En 2022, les prix en Corse étaient en moyenne 7 % plus élevés qu’en province, avec un écart encore plus marqué sur les produits alimentaires. Où en est-on aujourd’hui ? L’écart s’est-il creusé ou réduit ?
Beaucoup d’économistes font des analyses macro sur les prix sans tenir compte de la réalité des finances des enseignes de grande distribution.
En Corse, un acteur important était sous l’enseigne Casino, avec plusieurs hypermarchés et supermarchés. Le groupe Casino Guichard Monde a été sauvé in extremis au prix d’un démantèlement massif et d’une restructuration colossale. Des années de non-investissement, des prix élevés pour masquer les pertes de marge, une inflation post-Covid et un endettement massif ont conduit à cette situation.
L’arrivée de nouveaux acteurs, qui ont racheté ces magasins sous d’autres enseignes, pourrait modifier la structure des prix. Il faut aussi rappeler que la Corse compte de nombreux magasins de proximité, dont les prix sont structurellement plus élevés que dans les hypermarchés. L’absence de discounters et les contraintes de transport contribuent aussi à cet écart de prix
Concrètement, comment a évolué le panier type d’un ménage en Corse ces dernières années ? Quels produits ont le plus augmenté ?
Le panier moyen a augmenté d’environ 14 euros cette dernière année. Certains produits, comme la farine, l’huile d’olive, la moutarde ou encore le papier toilette, ont subi des hausses de 20 à 40 %, touchant aussi bien les marques premier prix que les marques distributeurs et nationales.
Quelles mesures ont été prises pour limiter ces surcoûts liés à l’insularité ? Ont-elles eu un impact réel sur les prix ?
La conférence sociale pour limiter les prix a été une initiative importante, menée par la Collectivité de Corse et les acteurs locaux. Les enseignes de grande distribution sont attentives à ces questions, car la variation de la consommation saisonnière – qui peut représenter entre 25 et 40 % du chiffre d’affaires annuel pour certains magasins – peut avoir un impact majeur sur leur rentabilité.
Mais un magasin reste une entreprise, avec des contraintes de rentabilité. S’il devient non viable, il finit par disparaître, ce qui peut avoir un impact encore plus négatif sur l’offre et les prix.
Quelles solutions pourraient être envisagées pour redonner du pouvoir d’achat aux Corses et limiter l’impact du coût de la vie ?
La conférence sociale doit continuer à proposer des solutions, mais il n’existe pas de mesure miracle. Le principal enjeu est de redonner un souffle à notre système productif insulaire. Si cela passe par l’arrivée d’investisseurs sur 5 à 10 ans, il faudra franchir le pas pour refaçonner l’économie, renforcer les entreprises locales, créer de nouveaux débouchés et, in fine, générer plus d’emplois et de salaires.
C’est une vision à long terme, mais pour l’instant, rien d’aussi ambitieux n’a été mis en place.



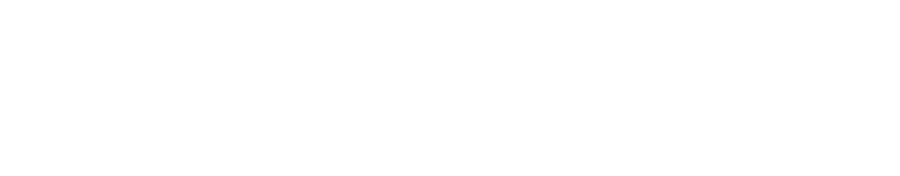








 Envoyer à un ami
Envoyer à un ami Version imprimable
Version imprimable






